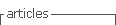Pour mon ami Djibril Diabone, homme sincère, généreux et intelligent, qui vient de nous quitter, trop tôt.
Temps, espace et…
En 2000, un jour, quand je travaillais sur le terrain à Oussouye, en Basse Casamance, j’ai rencontré un homme très âgé qui m’a dit en souriant qu’il avait plus de 120 ans. Bien qu’il soit toujours difficile d’estimer l’âge en fonction de l’apparence physique, il semblait évident que cet homme était beaucoup plus jeune que ce qu’il disait. Je pensais donc que c’était une blague dédiée au jeune étranger à la peau claire que j’étais à l’époque. C’était simplement une façon de me dire qu’il était vieux. Mais à ma grande surprise, il a insisté sur le fait qu’il avait 120 ans. Quelques jours plus tard, un autre homme m’a dit qu’il avait plus de cent ans. La troisième fois, ce fut une femme. Elle se disait aussi centenaire. J’ai finalement pris le défi très au sérieux et j’ai fini par savoir que, du point de vue local, les vieillards de l’endroit comptaient les années différemment de moi (et des jeunes Oussouyois aussi). Pour eux, une année, correspondait à la saison sèche et l’autre à la saison des pluies. Le temps était donc mesuré différemment.
Quelque chose de similaire m’est arrivée avec l’espace. En janvier 2000 j’ai eu la chance d’assister à la première présentation publique du roi Sibilumbay. Je me suis alors profondément intéressé au royaume d’Oussouye, également appelé Bubajum áai. Une des premières informations que je voulais avoir était l’extension territoriale et surtout le nom des villages constituant le royaume. Vu de loin, c’était une question très mal formulée (entre autres, parce que je ne connaissais pas à cette époque les relations entre territoire, parenté et initiations). Certains disaient que le royaume avait 16 villages ; d’autres disaient 21. Après de longs débats et des listes de lieux qui ne semblaient pas coïncider, j’ai résolu le problème : si l’on comptait à la façon sénégalaise, il y avait 16 villages ; mais si on comptait selon la façon locale, il y en avait 21. En fin de compte, si nous parlons du même ensemble territorial, on peut penser que la différence de nombre de villages n’a pas d’importance, puisqu’il s’agirait simplement d’une dénomination. Pas du tout.
Dans la première façon de compter, on incorpore des villages ou quartiers qui en réalité ne sont pas représentés dans la structure de pouvoir du royaume. Ils obéissent en effet à un système initiatique différent (les quartiers qui pratiquent les initiations kahat et ewaang (les esusaan ou esulsaan) ont une représentation, et ceux qui pratiquent le bukut (les esubukut ou esulbukut) en ont une autre, bien qu’ils soient représentés dans d’autres systèmes de pouvoir).
La seconde façon de compter met plus en lumière le pouvoir de certains quartiers, montrant ainsi la véritable influence de certains villages dans le royaume à travers une plus grande participation au conseil d’un autel (appelé báciin ou bákiin ; pl. uciin ou ukiin).2
La première manière de compter (16 villages) offre une réponse rapide et peu précise, tandis que la seconde (21) souligne qu’il existe un certain système de parenté, de religion et d’initiation qui obéit à un passé historique très complexe, plein de nuances, de devoirs et de réciprocités. En résumé l’espace avait aussi deux manières de se définir et de s’interpréter, avec des conséquences différentes de compter d’une manière ou d’une autre. J’ai progressivement réalisé que cette différence de réalités s’étendait à la grande majorité des domaines de la société. En même temps, et dans le même espace d’Oussouye, il y avait donc deux (voire plus) réalités opérationnelles, pas seulement en termes de temps et d’espace, mais aussi en termes politiques, judiciaires, économiques, écologiques, de santé...
Plusieurs cadres de référence
Si les habitants des sociétés du sud du Sénégal ont cette particularité, cela est dû à leur capacité complexe d’appartenir simultanément à plusieurs institutions et à collaborer à de nombreuses activités très structurées, ainsi qu’à jouir (et souffrir) de solidarités (et d’obligations) très diverses. Les Diola et autres groupes de la région (Bainounk, Manjack, Mancagne, Mandingue, Peulh) disposent de plusieurs cadres de référence culturelle qui fonctionnent en même temps, dans le même espace et, souvent, dans la même personne. En fin de compte, la région peut être définie comme un système complexe et profond de réseaux superposés. Parmi les Diola de la religion traditionnelle, ces réseaux promeuvent la solidarité - et parfois des affrontements - entre concessions, quartiers, villages ou royaumes qui peuvent être activés en relation avec des lignages restreints, des lignées étendues, des lignages utérins, des lignages liés aux responsabilités sur les autels de la religion traditionnelle, diverses associations de femmes et d’hommes, générations, groupes d’âge, divers groupes initiatiques avec des membres à des degrés divers, quartier d’adoption différent de celui du mari pour les femmes originaires de villages lointains (habitant le quartier du mari au moment du mariage, par la virilocalité), lignées qui adoptent des personnes pour des raisons rituelles, anciennes obligations héritées des lignages qui lors des guerres ont fui vers les villes voisines, etc. Cette catégorie de réseaux est intégrée à ce que de nombreux autochtones appellent mujooloayi ou makane mata ejolaayi, la « manière de faire des Diola » c’est-à-dire une façon de faire qui obéit à deux domaines : la parenté et la religion traditionnelle appelée, dans la région d’Oussouye, awaseena.
De même, sous l’égide de la structure de l’État sénégalais (et donc de la Constitution, des ministères, des cabinets, des tribunaux, etc.), les gens peuvent vivre en relation avec des partis politiques, des associations professionnelles, des syndicats, des groupes de ressortissants, des associations de parents d’étudiants, d’associations d’anciens élèves, de clubs, etc. De nombreux natifs de plusieurs sous-groupes diola englobent ces entités sous le nom de mululumayi, la « manière de faire des Blancs »3, et qui est associé à la façon de faire occidentale, héritée des colons.
Nous ne parlons pas de stratégies simples liées à des discours identitaires qui folklorisent l’identité, mais nous évoquons deux manières radicalement différentes de voir et de comprendre le monde, d’établir des relations avec les gens, de renforcer une solidarité, de donner la priorité à certains groupes, etc. Et cette différenciation a aussi sa correspondance avec les systèmes de pouvoir.
Álulumayi (le « Blanc »)
Dans ce contexte, comment, dans la région de Casamance, définit-on aujourd‘hui l’État sénégalais ? Dans certaines parties de la Basse Casamance, certains sous-groupes diola le définissent par le terme Álulumayi, un mot qui signifie « les Blancs ». Ce terme a été utilisé pour désigner les Français à l’époque coloniale. Certains informateurs disent qu’étymologiquement, le mot signifie « les curieux », car les « Blancs » (missionnaires, administrateurs français…) demandaient sans cesse des informations sur la vie locale. Depuis la fin du XIXe siècle, le système occidental (« les Blancs ») a colonisé la région et il y a implanté une nouvelle façon de voir le monde, notamment par le biais de l’administration coloniale, de la scolarisation et du catholicisme. Il l’a fait avec beaucoup de difficultés (voir les travaux déjà classiques de Roche, 1985, ou de Baum, 1999). Le fait qu’aujourd’hui, environ 60 ans après l’indépendance, les gens continuent à utiliser le mot Álulumayi pour se référer à l’administration - dans ce cas, sénégalaise - est un indice intéressant. L’administration française a agi lentement avec de nombreuses tensions entre catholiques et fidèles de la religion traditionnelle, en particulier entre les années 1930 et 1960. Quoi qu’il en soit, comme plusieurs chercheurs l’ont déjà signalé (Baum, 1990; Foucher, 2002; Marut, 2010), la région est finalement devenue un berceau d’étudiants. Après l’indépendance, l’administration sénégalaise s’est implantée, difficilement, avec de nombreuses tensions, dans plusieurs endroits de la région.4 Progressivement, la Basse Casamance s’est également distinguée par son intégration au système de participation démocratique au moment des élections. En témoigne le fait qu’en 1978 le premier département du Sénégal où l’opposition dirigée par Abdoulaye Wade a gagné à l’époque de Senghor (1960-1980) est précisément celui d’Oussouye (Marut, 2013). Cette confiance dans le système électoral se retrouve aujourd’hui, d’une certaine manière, dans divers secteurs de la société casamançaise. Mais, comme nous le verrons dans la section suivante, il existe une partie de la population qui, sur certaines questions, fait de plus en plus confiance à un autre système, un système ancré dans le mujoloaayi.
Notre « Assemblée Nationale »
Un jour, alors que nous tournions un documentaire sur la religion traditionnelle dans le royaume d’Oussouye, un des membres du conseil du roi5 a proposé cette explication:
Pourquoi les conseils autour d’un autel ? Lorsqu’il y a un problème, le conseil est appelé à étudier le cas et de la question à résoudre. Si quelque chose vous inquiète, vous pouvez l’expliquer au conseil. C’est comme s’il y avait un problème dans l’État, les gens peuvent discuter des lois, aller à l’Assemblée nationale et voter. Pour nous, l’Assemblée Nationale c’est le conseil royal et, avec Atabo6, ce sont nos lieux publics. Nous nous asseyons et discutons de nos problèmes. Il ne s’agit pas simplement de faire une cérémonie devant un autel, mais de s’asseoir et de discuter de nos problèmes. Une fois que la solution est trouvée, on appelle les gens et on leur dit : c’est ce qui a été décidé.
Certains peuvent soutenir que cette comparaison est juste une façon de dire, une plaisanterie pour se revendiquer de la modernité. Absolument pas. Les structures traditionnelles basées sur les autels et les initiations sont réellement très puissantes dans la région, comme beaucoup de chercheurs l’ont montré au cours de ces dernières décennies (Baum, 1999; Diatta, 1998; Journet-Diallo, 2007; Thomas, 1959; Trincaz, 1981). Ces structures font la distinction entre les autochtones et les allochtones, entre ceux qui peuvent se rendre dans la forêt sacrée et discuter de sujets importants (relatifs à la terre, aux ressources, au pouvoir, à la législation...) et ceux qui ne le peuvent pas. Cela vaut non seulement pour la population locale qui pratique la religion traditionnelle sur la rive sud de la Casamance, mais aussi dans certaines régions du département de Bignona, au nord du fleuve, où la plupart des gens pratiquent l’islam. Cela vaut autant pour les initiations masculines que pour les initiations féminines. Par exemple, dans de nombreux villages du département de Bignona, principalement habités par des populations musulmanes mandingue et diola, des femmes pratiquent une initiation liée à l’excision.7 L’excision ouvre l’accès à l’initiation féminine, et aux lieux de décision sur certains sujets importants pour les femmes et la localité. En 2018, au cours d’une enquête sur ce sujet, plusieurs femmes de différentes villes du département de Bignona ont dit que les campagnes contre l’excision ne fonctionnaient pas dans la région en partie parce qu’elles étaient considérées comme une imposition du nord, des « nordistes », et que personne de l’extérieur ne saurait leur imposer comment faire les choses importantes, qu’elles seules décident dans la forêt sacrée (Tomàs et al., 2018).
Quoi qu’il en soit, il est fréquent de trouver des personnes au sud du fleuve Casamance, qui considèrent que le système des autels de la religion awaseena et le mujooloayi constituent un système de participation politique. Ce système a été historiquement discrédité, à l’époque coloniale, par les missionnaires et les administrateurs français. Il l’est aujourd’hui par différents acteurs politiques et des membres des religions catholique et musulmane, y compris au sein de la population diola musulmane, principalement au nord du fleuve. Pendant des années, les missionnaires ont appelé Kata Elimay (terme diola qui signifie « Ceux des ténèbres ») les pratiquants de la religion traditionnelle awaseena. D’une certaine manière, certains nordistes, et même des Diola catholiques et musulmans de la région, continuent de considérer que les tenants de religion traditionnelle sont « les derniers sauvages de la République ».8
Cette expression d’origine coloniale, méprise, ignore ou oublie quelque chose de très important. Du point de vue local, la façon de faire des Diola, à travers les autels de la religion awaseena, est perçu comme plus proche, plus représentatif, plus opérationnel et plus légitime par la population locale (n’oublions pas la relation déjà citée entre ces institutions religieuses et les liens de parenté) que le système étatique. Il est perçu comme un système décentralisé, non organisé de forme pyramidale, et non tributaire de décisions politiques lointaines.9
Deuxièmement, outre cette fonction sociopolitique, les autels ont également une fonction éducative, liée aux initiations. Chaque zone possède un ou plusieurs systèmes d’initiation propres, liés à la circoncision, à la royauté ou à d’autres grands autels de la région. Dans ces systèmes initiatiques (et spécialement dans certains degrés initiatiques supérieurs), certains contenus culturels, religieux et historiques spécifiques peuvent être appris. Plusieurs lieux sacrés peuvent être accessibles. « Et dans ces lieux sacrés on discute de questions cruciales pour la société, même des sujets sur la vie et la mort », me disait un conseiller d’un autel du département d’Oussouye.
Troisièmement, le système d’autels locaux a une fonction liée à la justice (Ki-Zerbo, 1997) et à la résolution des conflits (Mark & Tomàs, 2011; Tomàs, 2005b, 2011). Certains chefs religieux peuvent promouvoir la réconciliation entre les personnes et les familles par le biais de rituels déterminés et de systèmes d’indemnisation entre les familles. Cette capacité est reconnue depuis quelques années par les représentants de l’administration sénégalaise. En 2012, le préfet d’Oussouye a déclaré que :
L’implication des chefs traditionnels est fondamentale et nous le ressentons tous les jours. Ils ne se limitent pas à la stabilité, ils interviennent également dans la recherche de la paix entre les villages et les localités. Ainsi, s’il existe un conflit foncier entre deux villages, nous nous tournons vers les autorités traditionnelles, qui nous aident, parce qu’elles sont très écoutées : quand ils parlent, les gens les écoutent.
Enfin, il ne faut pas oublier la composante redistributive et décentralisée de l’économie diola à travers les autels (sous forme de cotisations monétaires, de vin de palme, d’animaux, de tissus, etc.). Une pratique qui, en plus, échappe au contrôle des statistiques nationales et internationales.
En résumé, autour des autels, la société diola organise non seulement son système de croyances, mais également ses systèmes politique, judiciaire et éducatif et, d’une certaine manière, un système économique. Cela dit, on comprend aisément que l’autel - et par extension la forêt sacrée - symbolise le noyau de la société (non seulement parmi les Diola de la religion traditionnelle, mais également parmi certains pratiquants d’autres religions). En ce sens, détruire un autel ne serait pas comparable à brûler ou détruire une église ou une mosquée. Détruire un autel serait comparable à brûler un lieu sacré, détruire le siège de la cour de justice, de l’école, d’une banque, de « l’Assemblée Nationale » par conséquent.
Ce que certaines personnes appellent « tradition » n’est donc pas seulement un thème folklorique qui peut être instrumentalisé dans un certain contexte politique, c’est avant tout un système permettant de voir le monde, d’organiser la société et d’être en relation avec d’autres communautés et d’autres institutions, un système qui est en évolution et qui est toujours prêt à innover : rappelons ce que l’inspirant Robert Baum a déjà souligné : les autels ont toujours servi à sacraliser les innovations (1999).
Dans ce contexte, où se situe le conflit entre le MFDC et l’État sénégalais ?
Le conflit en Casamance et les cultures locales
Le conflit de la Casamance et son évolution ont été définis à partir de différentes disciplines et approches. Une grande partie de ces approches place la relation entre l’État et le MFDC au centre du débat, en insistant sur différents aspects tels que les griefs locaux, les stratégies politiques et militaires, les divisions au sein du MFDC, le rôle des États voisins (Gambie et Guinée-Bissau), le rôle de l’éducation, etc. Bien que beaucoup d’entre eux aient signalé les sentiments de griefs anciens qui existaient au niveau local à l’égard de l’État, la plupart des approches prennent finalement la question de la culture locale du point de vue discursif. Ils signalent que certains dirigeants du MFDC utilisent la « tradition » diola comme un label, uniquement pour montrer les profondes différences, présumées, entre l’État et la Casamance. En ce sens, certains chercheurs ont insisté, dans différentes perspectives, sur le travail de recomposition et de sélection de matériaux du passé par les indépendantistes casamançais afin de construire une certaine image de la Casamance (Awenengo-Dalberto, 2010; Evans, 2013; Foucher, 2007; Marut, 2010; Rudolph, 2016). Il est toujours utile de rappeler que cette recomposition du passé est pratiquée par tous les nationalismes, spécialement les nationalismes d’État qui ont, souvent, beaucoup plus de ressources humaines et économiques. Il est évident que chaque nationalisme - et chaque essai de (re)construction de la nation - sélectionne et interprète les faits du passé à son avantage.
Un cas intéressant est celui d’Aline Sitoé Diatta, qui, pour le moment, est une référence dans trois perspectives différentes10: pour les membres de la religion traditionnelle de la région des Diola Her de Cabrousse et dans une partie des régions voisines du Huluf et d’Esulaalu, Aline Sitoé était une prêtresse de l’autel Kassila (lié à la pluie et aux rizières). Il est rappelé dans de nombreuses cérémonies avec libations de vin de palme et de farine de riz11; pour les combattants du MFDC, en particulier pour l’abbé Diamacoune - voir son texte de 1980 - il s’agit d’une référence à la lutte pour l’indépendance des Diola contre toute puissance « étrangère », y compris, de son point de vue, les Sénégalais (Voir Darbon, 1985, pp. 132-133) ; pour le gouvernement sénégalais, il est une référence de la nation sénégalaise dans sa lutte contre le colonialisme français : il fut utilisé à partir des années 1990, à l’époque d’Abdou Diouf, pour faire face à l’imaginaire sécessionniste. L’importance de sa figure a été incorporée au Sénégal dans les manuels scolaires et son nom apparaît aujourd’hui dans toute la Basse Casamance dans les écoles, terrains de football, etc.
Mais au-delà de la question discursive - laquelle, sans aucun doute, peut toujours finir par être performative - mon intérêt est centré sur les actions concrètes des membres de la religion awaseena dans le contexte du conflit.
Religion traditionnelle et conflit en Casamance
Plusieurs informations indiquent qu’au sein du MFDC, il y a toujours eu des membres des trois principales religions : traditionnelle, musulmane et catholique. Au-delà du fait que Diamacoune a utilisé d’une manière ou d’une autre la religion traditionnelle comme marqueur d’identité (label) pour différencier la Casamance du nord du Sénégal, il est évident que la religion traditionnelle a joué un rôle très important depuis le début du conflit. Il est nécessaire ici de rappeler que nous ne pouvons pas parler d’une unique « religion traditionnelle » diola, mais que selon le groupe ou sous-groupe culturel, le royaume, la région, la ville et même le quartier, nous avons de systèmes de croyances et de pratiques avec des fondements communs, mais assez divers. En tout cas, il n’y a jamais eu dans les sociétés diola un pouvoir centralisé organisé de manière pyramidale sur la base de la religion traditionnelle.
Dans l’intéressant travail de René Capain Bassène (2015), Ndèye Marie Thiam, coordinatrice de la Plateforme de femmes pour la paix en Casamance, souligne « qu’il faut prendre en compte l’aspect culturel et mystique à travers l’implication de certains dignitaires, cela peut sembler relever de l’irrationnel, mais il faut être Casamançais pour le comprendre ». Sans aucun doute, les personnes extérieures aux réalités locales, qui ne connaissent pas la religion traditionnelle, peuvent trouver des aspects irrationnels (fait commun à toutes les religions, mais il prend une dimension spéciale lorsqu’on parle de la religion traditionnelle dans un État à majorité écrasante musulmane et en Basse Casamance, où le catholicisme a un poids sociopolitique très fort). Cette supposée irrationalité aux yeux des étrangers (ajaala, sing. ; kujaala, pl.) n’est rien de plus qu’une rationalité inconnue, une réalité qui suit d’autres logiques. Il est important de comprendre ces logiques.
Si nous nous contentons d’analyser la situation en mettant l’État au centre du débat, nous éclairons qu’une partie de la réalité. Il est intéressant de voir que, à quelques exceptions près, c’est seulement au moment où des chercheurs casamançais (Paul Diédhiou, René Capain Bassène, Lamine Diédhiou, Jean-Baptiste Manga...) ont commencé à publier leurs travaux, que les relations entre le conflit et les religions traditionnelles ont commencé à être traitées en profondeur.
De la même façon, interviewé par R. C. Bassène, Cherif Bassène fournit un témoignage éclairant, qui oblige à des réflexions cruciales à cet égard. Bien que la citation soit vraiment très longue, nous estimons ce témoignage indispensable :
Pour mettre fin à ce mépris de la part des Sénégalais à l’égard des Casamançais, noté sur tous les plans, mais surtout au niveau de celui culturel, nous avions décidé de nous organiser à partir de 1979 jusqu’à 1980. [...] Pour ce faire, l’un de nos anciens, très au fait des pratiques mystiques, nous a conseillé de procéder à une préparation de notre projet sur ce plan avant de l’exposer au grand public. Il fallait concrètement prendre des mesures et engagements mystiques pour fidéliser les sympathisants, mais surtout pour obliger tout un chacun de ne jamais trahir le secret ou de le révéler aux forces de sécurité quoi qu’il advienne, car nous étions convaincus que c’est seulement dans la discrétion parfaite que nous atteindrons notre objectif. A cet effet, nous avons procédé à des cotisations jusqu’à atteindre le montant de 30 000 CFA ; ensuite nous avons décidé de consulter des individus et ils nous ont tous, de manière séparée conseillés de nous rendre dans le royaume du Moff-Awi (c’est-à-dire l’entité qui constitue l’actuelle commune d’Enampore), d’aller à un village dont tu garderas le nom, où se trouve un fétiche très puissant dont tu ne révéleras pas le nom, c’est là où on trouvera ce qu’il nous faut pour atteindre notre objectif. Ainsi donc, tout débuta dans ce village vers la fin de l’année 1980. Quand nous sommes arrivés dans ce village, nous avons demandé à rencontrer le responsable du fétiche, il nous reçut et après explications, il a convoqué ses collaborateurs. Au-delà de la prise de contact, la décision fut retenue de faire la cérémonie le même jour. Heureusement pour nous, nous avions pris le soin d’acheter du vin de palme à Essyl, un village situé sur la route. Il nous manquait le bouc pour le sacrifice. Dieu merci, c’est le responsable du fétiche lui-même qui est allé chercher son propre bouc. Quand nous avions voulu le payer, il nous a répondu qu’il nous le donnait gracieusement en guise de contribution pour le noble combat que nous avons l’intention de mener. La cérémonie a débuté vers 21 heures, j’étais le seul de tout le petit groupe à être autorisé à assister à tout le processus. Mes amis dont certains étaient de ce même village, mais d’âge plus jeune, étaient assis à côté et nous observaient. Le travail a duré jusqu’à presque une 1 heure du matin. Quand tout fut terminé, nous avons quitté pour rallier Ziguinchor, direction Mangocouro. Ils nous avaient remis une sorte de sac traditionnel dans lequel était placée une petite jarre qui contenait tout l’arsenal mystique qui avait été préparé. L’un d’entre nous (tu garderas pour toi son prénom, car il est encore en vie), avait la lourde charge de le porter. J’avais la lourde responsabilité une fois à Ziguinchor de procéder à la mise en place ou installation de l’autel du fétiche en suivant exactement les consignes qui m’avaient été dictées. Je n’avais pas droit à la moindre erreur. Vu la lourde responsabilité et charge qui pesaient sur moi, mon propre oncle, qui par ailleurs est un collaborateur du responsable du fétiche, a pris la décision de nous accompagner jusqu’à Ziguinchor afin d’assister à la mise en place du fétiche à Diabir. Il ne voulait pas que son neveu commette une erreur qui demain se retournerait contre lui et sa famille, car le fétiche ne pardonne pas. C’est donc ce fétiche qui a été implanté de mes mains sous la supervision de mon oncle à Mangocouro plusieurs mois avant la marche du 26 décembre 1982. Nous avons ensuite envoyé trois des nôtres chercher des choses en Guinée-Bissau dans deux localités (dont tu tairas les noms). Ce n’est qu’après que tout fut mystiquement bien préparé, que toutes les démarches, les nombreux autres sacrifices et cérémonies aient été effectués que nous avions pris la décision d’impliquer les femmes en nous rapprochant en tout premier lieu de Joana Cabo, la responsable du fétiche des femmes de Djibélor. En milieu traditionnel chez nous, les femmes n’assistent jamais à la réunion où se prend la décision d’aller en guerre. Elles n’assistent pas au « cabaye », le rituel d’avant le passage à l’acte. Elles sont informées après que tout soit fini d’être préparé. A cet effet, elles se rangent automatiquement du côté de leurs époux et fils et s’organisent mystiquement de leur côté afin de leur apporter le soutien nécessaire. (Bassène, 2015, pp. 150-152)
Ce témoignage fascinant nous ouvre différentes portes pour comprendre diverses questions - y compris le rôle, que l’on oublie parfois, de certains Baïnounk au début du conflit, le rôle crucial des structures de la parenté et le rôle actif des femmes, la liaison rituelle entre villages transfrontaliers -, mais concentrons-nous que sur un aspect qui devrait être évident : une société structurée selon la religion traditionnelle ne peut être impliquée dans la lutte contre le pouvoir de l’État que par le biais de valeurs, de pratiques et de relations liées à cette religion (bien entendu, en relation avec d’autres structures).12 Et non seulement pour des raisons de foi, ou pour le fait de croire que les uciin protégeront les combattants, mais pour de nombreuses autres raisons qui obsèdent les anthropologues : des raisons liées à la sociabilité, à la parenté, aux liens rituels, à la redistribution économique, à l’efficacité symbolique, au capital social, à la relation entre pouvoir et autorité, à la constante adaptation et actualisation des pratiques de la religion traditionnelle, etc.
Considérant les différentes valeurs que la religion awaseena a pour de nombreux autochtones (même s’ils ne pratiquent pas exactement les mêmes rituels, et ne recourent pas aux même autels - puisque la religion awaseena n’est ni homogène, ni centralisée, comme nous l’avons déjà souligné), il est intéressant de rappeler que l’un des premiers épisodes avec victimes de l’armée après la manifestation de 26 décembre 1982 s’est produit en 1983 lorsque trois soldats ont été tués alors qu’ils s’approchaient précisément de la zone où était installé l’autel de Diabir.13 Sans aucun doute, l’État sénégalais connaissait le pouvoir de la religion traditionnelle. Dans l’un des documents circulant en Casamance dans les années 1980, et signé par la Résistance Casamançaise, il est expliqué « Pour mieux brouiller les populations, on rase des autels et des bois sacrés pour implanter des mosquées ».14
En fait, la répression contre la population de religion traditionnelle diola n’était pas généralisée, mais elle n’était pas non plus exceptionnelle. Cette affirmation est confirmée par plusieurs témoins, interrogés à différents moments du travail sur le terrain, ainsi que par des rapports d’Amnesty International des années 1990 (AM, 1996).
Un autre cas a reçu une certaine publicité parce qu’il concerne l’entourage d’un représentant traditionnel du pouvoir spirituel casamançais, il s’agit de la reine Anna Sambou de Djiwante, dans le département d’Oussouye. Après avoir raccompagné chez elle la reine qui venait de faire une tournée de la région, six hommes, Adama Sambou, Aliou Sambou, Alassane Amany Sambou, Fodé Sambou, Sidate Sambou et Malang Diatta, tous originaires du village de Mlomp, furent arrêtés par les militaires, le 17 juillet 1995, à Edjoungo, au sud-ouest de Ziguinchor. Les familles avertirent la gendarmerie d’Oussouye et la mairie de Ziguinchor mais on n’a retrouvé nulle trace des « disparus ». Les familles, à qui les militaires auraient dit que leurs parents avaient été exécutés au pont de Niambalang, n’auraient même pas osé organiser les funérailles de leurs proches (A. I., 1996, p. 13). Les exemples de stigmatisation, d’exclusion et de persécution du monde diola traditionnel ont été cités par de nombreux et divers auteurs (Diédhiou, 2011; Marut, 2010 ; Moreau, 2001 ; etc.).
Population locale, conflit et religion traditionnelle dans le royaume d’Oussouye15
Des auteurs tels que De Jong (2001), Marut (2010) et Foucher (2007) ont remarquablement souligné que plusieurs hommes politiques casamançais ont cherché à se légitimer en participant à des initiations religieuses, ou en créant des associations de défense de la culture diola. Des hommes politiques sénégalais du nord du pays l’ont également fait, comme par exemple Abdoulaye Wade dans ses actes en faveur de la figure d’Aline Sitoé à Kabrousse (en février 2012). En utilisant la tradition pour obtenir des avantages électoraux ils ont instrumentalisé les autorités traditionnelles à leur profit (comme ils utilisent d’autres domaines). Il faut dire que l’instrumentalisation ne fonctionne pas à sens unique. Les chefs religieux locaux sont également des agents actifs dans leurs relations avec les autorités de l’État. Lorsqu’un roi reçoit des dirigeants politiques et des membres du MFDC, il tente de montrer à sa population qu’il est capable d’exercer la fonction que la société lui a confiée (amener la paix, au sens large du terme). Il peut représenter toutes les sensibilités qui cohabitent dans son royaume. Loin des médias et des États, les autorités traditionnelles ont agi en multipliant les actions en faveur des populations locales, à la fois au sud et au nord du fleuve Casamance (Baum, 2015; Mark & Tomàs, 2010). Comme les anthropologues ont longtemps essayé de le montrer, l’État n’est pas le seul moyen de s’organiser en Basse Casamance (Journet-Diallo, 2007; Linares, 1992; Thomas, 1959). « L’État est loin, les candidats arrivent chaque fois qu’il y a la campagne électorale, et après ? Après ils partent. Et nous ? Nous continuons à faire les choses à notre manière », me disait un témoin. Et souvent, à travers « cette manière » on peut résoudre de façon plus efficace beaucoup de problèmes quotidiens (Diédhiou, 2013; Manga, 2015; Mark & Tomàs, 2010 ; Tomàs, 2005a, 2005b, 2011).
Notre analyse en tant que chercheur étranger est sans aucun doute complexe, en raison notamment du secret pratiqué par une partie de la population, en référence à ses pratiques de la religion traditionnelle, non seulement envers les étrangers, mais aussi au cœur même de la société (les femmes vers les hommes et vice-versa ; des générations âgées à l’égard des les plus jeunes ; des membres des différents grades et des différents contextes initiatiques ; l’exigence du secret entre villages, royaumes, etc.). Cette diversité culturelle et cette complexité posent un grand défi.
Dans cette partie, nous essayons de montrer comment, dans le contexte des initiations et des forêts sacrées, les populations cherchent, à travers leurs systèmes culturels, des solutions efficaces, loin de l’arène politique étatique ou régionale. On a déjà tenté de montrer comment, à travers différents rituels de la religion traditionnelle awaseena, les populations essaient de mettre en place des stratégies de règlement de conflit (Mark & Tomàs, 2010 ; Puigserver, 2014; Tomàs, 2005a, 2005b, 2011).
Nous nous sommes aussi intéressés aux autels, comme l’Elung et le Hulem, auxquels les Diola de la zone ont recours en cas de crime de sang (donc, l’endroit où doivent aller les soldats de l’armée et les combattants du MFDC originaires de cette zone).
Nous proposons ici trois cas qui nous permettent de préciser la relation entre population locale, conflit et religion traditionnelle, en particulier dans les espaces liés à diverses initiations.16 Comme nous l’avons déjà expliqué, de nombreux Diola de religion traditionnelle expliquent que les autels - en particulier, les réunions et les cérémonies autour de ces autels - peuvent être un lieu de débat. Une fois qu’on est initié - ce qui provoque déjà une exclusion, comme dans toutes les religions - on peut parler, dans le contexte des cérémonies, de nombreux problèmes et, dans plusieurs cas, on peut trouver des solutions concrètes, et éventuellement modifier le cours des événements. Dans d’autres cas, non.
La grande initiation royale en tant que lieu de paix
Entre 2000 et 2002, lorsque je travaillais sur le terrain à Oussouye, j’ai demandé à plus de 300 élèves d’écrire des textes sur leur identité. Plusieurs d’entre eux ont lié l’identité casamançaise à l’identité diola à la religion traditionnelle ; et la religion traditionnelle à la royauté et aux initiations d’Oussouye (Anonymisé). C’était là une première piste pour connaître l’opinion des jeunes, lesquels se sont montré très intéressés par des questions portant sur la tradition. Ce premier indice a été confirmé au fil des années par d’autres techniques de recherche et, surtout, par la célébration de l’ewaang d’Oussouye en 2011, au cours de laquelle environ 3500 enfants, jeunes et adultes des patrilignages du royaume ont été initiés.17L’ewaang est l’initiation maximale sur les terres diola d’Oussouye (de tradition esusaang, et pas esubukut) et que chaque roi d’Oussouye doit organiser.18 La dernière initiation ewaang avait été célébrée en 1962. Aussi la tension était-elle maximale dans la période précédant juin 2011, d’autant que le contexte était difficile : certains jeunes à initier étaient des combattants du MFDC. Ils se trouvaient dans la zone frontalière de la Guinée-Bissau. D’autres étaient des officiers de l’armée sénégalaise, parfois en poste loin d’Oussouye. Une bonne partie des jeunes avaient un point de vue politique sur le conflit. Des efforts furent déployés par des représentants de la royauté et de l’administration sénégalaise pour que les combattants du MFDC puissent atteindre Oussouye sans problème compte-tenu des contrôles militaires. Dans une interview en 2011 le roi déclara :
Lors de l’initiation, ils doivent tous venir, qu’ils soient soldats du gouvernement ou du MFDC, ils sont tous des enfants du royaume et doivent pouvoir assister à l’initiation. Elle montre en effet que nous sommes sur le même pied d’égalité, l’initiation est un lieu de paix.
Selon diverses informations, les combattants du MFDC originaires des localités du royaume d’Oussouye réussirent à arriver sans difficulté pendant les jours d’initiation, et furent initiés avec d’autres jeunes et hommes de la région, y compris des militaires sénégalais (cousins, voisins ou amis). Selon un témoin, « Chacun est revenu ensuite à sa vie normale, dans la forêt avec les rebelles, ou dans l’armée avec les soldats ». Dans ce cas, les autorités traditionnelles considèrent que leurs initiations et leurs rituels sont un moyen de parvenir à la paix, et un moyen d’intégrer tous les habitants de la région, quelle que soit leur position dans le conflit.19
« Les maîtres de la circoncision doivent nous écouter »
L’un des épisodes les plus stimulants pour éclairer la relation entre conflit et religion traditionnelle s’est produit en 2009 à Siganar, l’un des plus grands villages du royaume d’Oussouye, lorsque furent kidnappés par des jeunes du MFDC, sept des huit initiateurs de la circoncision masculine, le kahat (et donc dans le contexte initiatique esusaang, lié à la royauté d’Oussouye, et pas dans le contexte esubukut, qui est une initiation à la circoncision masculine différente, pratiquée dans d’autres villages de la région). Selon les informations recueillies au cours de plusieurs entretiens avec des habitants du village et avec deux des otages, les jeunes ont emmené les principaux chefs de l’initiation de chacun des quatre grands quartiers de Siganar (tous les responsables et adjoints de l’autel (báciin) de chaque quartier, sauf un qui était très âgé). La conséquence immédiate fut la suspension du kahat, dont le commencement était prévu peu après. Les sept hommes ont passé plusieurs jours dans une forêt avec des jeunes du MFDC.20 « Ils nous ont bien traités, nous avons eu le temps de parler. Nous avons pu écouter leur version » dit l’un des kidnappés. Les motifs de l’enlèvement étaient divers - même parmi les kidnappés. Pour l’un d’eux : « C’étaient des questions mystiques, des affaires intérieures du village ; mais eux, les jeunes, avaient raison, nous avons compris ». Selon un autre otage le problème était que « lors de la dernière initiation, des choses très graves s’étaient produites, et nos jeunes ne voulaient pas que cela se reproduise, ils nous ont demandé de modifier certaines de nos pratiques ». Une autre version obtenue parmi certaines personnes de la région est que non seulement les initiateurs n’avaient pas informé les jeunes du maquis des préparatifs de la cérémonie, mais qu’ils avaient également donné aux militaires une liste des jeunes participants « rebelles ». Cette version ne fut confirmée par aucun des deux initiateurs interrogés. Quoi qu’il en soit, alors que plusieurs médias soulignèrent le kidnapping et que la lecture de l’information pouvait laisser penser que les membres du MFDC étaient hostiles à la « tradition », selon nos informations provisoires, l’objectif des ravisseurs était précisément l’inverse.21 Bien que nous n’ayons pas encore pu compléter et confronter les informations avec d’autres protagonistes - nous espérons pouvoir le faire lors de futurs séjours dans la région -, toutes les explications obtenues conduisent à une conclusion importante ; les jeunes combattants du MFDC originaires de la zone voulaient participer activement à ce qui relève de la tradition, et non agir contre la « façon de faire » des Diola. En fait, en 2016, le kahat s’est finalement tenu à Siganar, sans incident grave à souligner. Dans ce deuxième cas, il est plausible de penser que certains membres du MFDC ont utilisé leur pouvoir pour intervenir auprès de certaines personnes dans le cadre d’une affaire traditionnelle.22
Débats et tensions dans une forêt sacrée féminine
Les femmes de Casamance sont apparues dans l’analyse du conflit surtout à travers l’activisme d’associations et de plateformes pour la paix installées à Ziguinchor. Mais la réalité des relations entre les femmes et le conflit dépasse de loin l’activité de ces organisations, que certains interlocuteurs considèrent comme non représentatives de la culture traditionnelle diola : « Là-bas à Ziguinchor, ils sont de religion traditionnelle, mais ici ils ne se sont jamais approchés d’un fétiche », déclare un témoin. Le rôle de ces plateformes a été discuté par d’autres auteurs (Beck & Foucher, 2009 ; Foucher, 2007 ; Diédhiou, 2011). En bref, l’existence de ces plateformes à Ziguinchor est un exemple de la manière dont des femmes de différents domaines et origines s’entremêlent dans un contexte urbain et migratoire, dans lequel la patrilinéarité et la virilocalité peuvent être vécues différemment.
Dans cette partie, nous ne souhaitons pas nous concentrer sur ces plateformes urbaines, mais plutôt sur les autels awaseena du royaume d’Oussouye. Nous voulons montrer que, de la même manière que les autels masculins et leurs initiations, les autels de femmes, très ancrées au terroir à travers l’alliance, la parenté et la maternité, jouent un rôle à certains moments du conflit. Leur implication en cas de crise a été récurrente au cours de l’histoire, que ce soit face à la répression coloniale, aux sécheresses, aux épidémies, aux affrontements entre peuples, aux vols à grande échelle, aux crises éco-économiques23 ou, plus récemment, dans le conflit entre le MFDC et le gouvernement sénégalais. En 2012, dans le département d’Oussouye, la responsable d’un des principaux autels féminins m’a affirmé que lorsque la révolte armée a éclaté - au début des années 1990 - des femmes s’étaient rassemblées devant leurs autels. « Ensuite, elles se sont rencontrées dans la forêt pour parler, parler et parler, et finalement la chose s’est calmée ». À la même époque j’ai eu l’occasion de m’entretenir avec deux femmes âgées du royaume d’Oussouye sur le conflit casamançais, et sur la possibilité de le résoudre par le biais des autels féminins de la religion traditionnelle.24 Les deux femmes ont convenu qu’il était très difficile à ce moment-là (2012) de débattre dans le bois des femmes et de trouver une position commune, car « il y avait des femmes avec leurs enfants “dans la brousse” et des femmes qui n’en avaient pas, et il était difficile de s’entendre. Tout le monde a ses raisons. Nous avons besoin de temps ». Dans ce troisième cas, le débat s’est déroulé au sein des structures du pouvoir féminin, mais une formule de consensus n’a pas été trouvée à ce moment-là. Quoi qu’il en soit, la chose la plus remarquable est qu’à l’échelon local, tant dans les structures du pouvoir masculin que dans celles du pouvoir féminin, la pluralité des points de vue et le caractère inclusif du débat sont bien plus grands que dans les centres de pouvoir de l’administration sénégalaise.
Ces trois exemples montrent donc, le dynamisme de la religion traditionnelle, ses multiples relations - coopération, conflit, coexistence en parallèle avec les autorités -, et sa capacité à intervenir à plusieurs reprises dans la résolution des tensions locales causées par le conflit ou dans le contexte du conflit. Ils montrent, selon la perspective autochtone, les succès divers du pouvoir de dialogue des structures traditionnelles. Insistons sur le fait que cela n’implique pas que les membres de la religion traditionnelle se positionnent ou se soient unanimement positionnés en faveur du MFDC ou contre lui. Bien au contraire. Les structures liées aux initiations de la religion awaseena montrent clairement la pluralité de la société diola par rapport au conflit et à sa résolution.25 Et ceci malgré et grâce au secret.
Conclusion : la paix sans la perspective locale ?
L’ami Ramon Sarró rappelait que même le paysage est culturel. Lorsqu’on parle de règlement du conflit casamançais, veut-on vraiment respecter et connaître les cultures locales, la vision locale, la compréhension locale ?
En Basse Casamance les personnes ont plusieurs cadres de référence et d’action, et, sans doute, au sud du fleuve, « la façon de faire des Diola » - qui est plurielle et pas homogène - est perçue souvent par les autochtones comme la plus proche, la plus représentative, la plus efficace et la plus légitime. En ce sens, à Ziguinchor et en d’autres lieux de Basse Casamance, j’ai entendu à plusieurs reprises formuler l’idée suivante : « Le conflit de la Casamance ne sera pas résolu tant que la lance qui a été lancée à un fétiche de la région n’aura pas été enlevée ». Pour un membre de la religion traditionnelle - et aussi pour certaines personnes d’autres religions de la zone - l’image est très puissante et significative. Le báciin est perçu comme le grand centre rituel, social, politique, éducatif, judiciaire et économique des sociétés diola de religion traditionnelle. Si, comme nous avons essayé de le montrer, le contexte des cérémonies et du système d’autels de la religion traditionnelle peut faciliter un espace de débat, il ne fait aucun doute qu’au-delà des négociations politiques improbables et des actions menées par la coopération internationale, un élément crucial consiste à respecter les formes d’organisation et les formes de compréhension de la réalité autochtones. La résolution du conflit, dans les grands débats sur la paix, est presque toujours pensée en termes politiques et économiques et rarement en termes culturels, religieux et sociaux. Loin des bureaux de Dakar, loin des campagnes électorales, des médias, des ONG, des marches à Ziguinchor, il existe une réalité vitale et dynamique. Parfois, cette réalité complexe et plurielle collabore avec l’État, qui parfois utilise cette réalité à son avantage. Parfois cette réalité utilise l’État. Le fait que l’État reconnaisse avoir parfois recours aux autorités traditionnelles, le fait que certains hommes politiques soient amenés à rechercher la légitimité à travers des initiations, le fait que plusieurs présidents sénégalais aient déclaré publiquement qu’il est important de valoriser les cultures de la Casamance, montrent que l’État sénégalais reconnaît (de différentes manières) le pouvoir de « la façon de faire diola ». Ce pouvoir ne peut être organisé par l’État sénégalais et il sait qu’il ne peut le contrôler. Une manière de fonctionner qui, comme l’a montré la grande initiation ewaang à Oussouye en 2011 - avec une très forte participation - est souhaitée par la population locale. Le succès d’autres initiations en d’autres lieux de la Basse Casamance peut être interprété de la même manière. En fait, de nombreux habitants de la région considèrent que les institutions traditionnelles, leurs valeurs et leurs pratiques les représentent davantage que l’État sénégalais, ou que la proposition d’indépendance du MFDC.
Le règlement du conflit repose sur une exigence : coordonner, ou faire dialoguer, les institutions de l’État et les diverses factions du MFDC avec l’énorme pluralité socioculturelle de la région. Peut-être que la paix, au sens politico-militaire, arrivera en Casamance dans un futur proche, et qu’à l’avenir les armes se tairont. Mais croyons-nous vraiment qu’une paix durable puisse s’établir dans la région si l’État et toutes les parties impliquées dans le conflit ne reconnaissent pas les différentes visions locales sur la démocratie, la représentativité, la justice et le développement ?