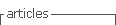Mais que diable allaient-il faire dans cette galère ?1
Après plusieurs années d’accalmie, l’absence de résistance des combattants indépendantistes casamançais aux ratissages de l’armée sénégalaise en 2018 et 2021 peut être vue comme le signe qu’ils sont, autant que les populations qu’ils prétendent représenter (Marut, 2002), « fatigués » par une lutte armée dont ils n’ont plus grand-chose à espérer, tant le rapport de forces leur est devenu défavorable. On sait ce qu’un tel résultat doit à la stratégie du pourrissement adoptée depuis longtemps par Dakar (Marut, 2010). On sait aussi ce qu’il doit aux ouvertures du président Macky Sall en direction de cette rébellion et de la communauté internationale, rendant possible ce qui ne l’était pas avec son prédécesseur, Abdoulaye Wade. Mais on sait peut-être moins ce qu’il doit à la diplomatie américaine.
L’implication de la plus grande puissance mondiale dans le règlement d’un des plus petits conflits du continent africain peut surprendre. Non seulement parce que l’Afrique n’est pas une priorité sur l’agenda de Washington. Mais aussi parce que pas plus la Casamance que le reste du Sénégal n’apparaissent a priori comme des enjeux majeurs. Que diable les Américains sont-ils donc venus y faire ? Dans quel but ? Et en ont-ils la capacité ? Dans le monde post-Guerre froide devenu multipolaire, peuvent-ils encore prétendre peser sur la situation intérieure de pays du Sud largement ouverts à toutes les influences, comme l’est le Sénégal ? Et réussir là où ses dirigeants ont « apparemment » échoué pendant plus de trente ans ? A travers le décryptage du « processus de paix » gouvernemental appuyé par les États-Unis, l’analyse géopolitique2 mise en œuvre ici, étayée par plusieurs années de travail de terrain, permet d’apporter une réponse paradoxale à ces questions : ce processus est bien une réussite, mais il ne l’est que dans la mesure où son véritable objectif est autre que celui qui est affiché.3 C’est ce que font apparaître successivement le choix du lieu, le choix de la méthode et le choix du moment de l’intervention américaine. Mais c’est aussi ce que font apparaître les limites de cette intervention.
Le bon endroit
Conflit local, pompier global
L’Afrique subsaharienne n’a jamais été et n’est toujours pas une priorité stratégique pour les États-Unis. Sauf au plus chaud de la Guerre froide, dont la frontière entre le Sénégal et la Guinée portugaise (devenue Guinée-Bissau) a été l’un des fronts4, leur intérêt pour le continent s’est pendant longtemps limité à sa partie orientale, essentiellement la Corne. Encore était-ce pour des raisons stratégiques extérieures à l’Afrique (le contrôle du Moyen-Orient). Malgré l’échec cuisant de l’opération Restore Hope en Somalie en 1993, la zone a gardé toute son importance pour eux, comme en témoigne l’implantation à Djibouti, en 2003, de ce qui reste la plus grande base militaire américaine du continent. Mais de nouveaux défis ont rapidement obligé Washington à s’intéresser à l’Afrique en tant que telle.
Bien qu’elles ne les concernent pas directement, les sanglantes guerres civiles des années 1990 en Afrique Centrale (Rwanda, RDC…) et en Afrique de l’Ouest (Libéria5, Sierra Leone…), obligent les États-Unis à s’impliquer pour afficher leur statut de seule superpuissance mondiale. Ce qui les conduit à élaborer une véritable politique africaine. Le président Clinton en dessine les contours en 1998, lors de son périple africain qui, ce n’est sans doute pas un hasard, s’achève à Dakar : l’Afrique noire en tant que telle, y compris sa partie francophone, commence à intéresser la Maison Blanche.
Quatre mois plus tard, les Américains doivent relever un défi d’une autre nature. Au Kenya et en Tanzanie, ils sont les cibles des premiers attentats d’Al-Qaida. Le continent africain devient alors l’un des lieux et l’un des enjeux de la « guerre globale contre la terreur » qu’annonce G.W. Bush trois ans plus tard, au lendemain des attentats du 11 septembre 2001 sur le sol des États-Unis. En témoigne, en 2002, le lancement de la Pan-Sahel Initiative(PSI).6 Celle-ci devient en 2005 le Trans-Saharan Counter Terrorism Partnership(TSCTP), élargi à de nouveaux pays, dont le Sénégal.
Mais l’Afrique subsaharienne devient aussi, dans le même temps, le lieu et l’enjeu d’un autre défi pour la puissance américaine. Comme à la fin du 19e siècle, elle est en effet l’objet d’une compétition entre puissances étrangères, dans laquelle on trouve des pays émergents, dont certains, comme la Turquie et l’Iran, sont hostiles aux États-Unis. Mais on y trouve aussi leurs deux principaux adversaires, la Russie7 et surtout la Chine, qui fait une percée spectaculaire sur le continent (Beuret & Michel, 2008). Au-delà du contrôle d’immenses ressources naturelles et de marchés potentiellement prometteurs, ce qui est en jeu pour les Américains, dans cette nouvelle course vers l’Afrique, dans laquelle ils ont pris du retard, est, là encore, la préservation de leur hégémonie mondiale (laquelle passe aussi par un contrôle des ressources).
C’est pour toutes ces raisons que, sans être une priorité, l’Afrique occupe désormais une place non négligeable dans la politique étrangère de Washington. Et cette place, elle ne l’a pas quittée, malgré les velléités de Donald Trump de réduire l’aide au développement et la présence militaire américaine sur le continent, notamment au Sahel. Ces deux volets constituent en effet le socle de la politique africaine des États-Unis8: s’appuyer sur des relais bien ciblés de leur puissance, à charge d’en renforcer les capacités militaires et économiques. C’est ce qui explique leur choix du Sénégal.
Les atouts du Sénégal
A priori, aucun enjeu majeur ne justifie ce ciblage à la fin des années 1990. Le pays ne possède pas de ressources minérales stratégiques connues9, le risque terroriste y est faible et la pénétration chinoise pas plus forte qu’ailleurs. De surcroît, il est considéré comme une chasse gardée de la France. Cependant, par rapport aux défis que doit relever Washington, il présente de sérieux atouts.
En premier lieu, sa position géographique d’interface. Pointe avancée du continent africain dans l’Atlantique, le Sénégal en est la porte d’entrée la plus proche pour les Américains. Il constitue en même temps pour eux un excellent poste d’observation des importants flux criminels qui traversent l’Atlantique et le Sahara, et qui sont des facteurs d’insécurité pour le continent et au-delà. Last but not least, sur le flanc sud-ouest d’une zone sahélo-saharienne devenue l’un des foyers majeurs du djihadisme, le Sénégal peut être utilisé comme un lieu d’accueil et de redéploiement de forces d’intervention rapide dans la sous-région, à l’image des forces françaises pré-positionnées à Dakar.
L’autre grand atout du Sénégal aux yeux de Washington tient à son positionnement politique. Considéré comme un pays musulman modéré, il jouit d’une bonne image internationale, répondant peu ou prou aux critères de Washington en matière de « bonne gouvernance » : stabilité politique, armée obéissant au pouvoir civil, liberté d’expression, élections libres, société civile dynamique… Et le Sénégal entretient de bonnes relations aussi bien avec l’Occident, dont il est un pilier depuis sa naissance, qu’avec le monde arabe et le monde musulman - il est membre de l’Organisation de la Conférence islamique. Enfin, dernier point, et non des moindres aux yeux des Américains, le rêve de l’émergence porté par Abdoulaye Wade et poursuivi par Macky Sall, conduit Dakar à s’ouvrir largement sur le monde extérieur dans une optique néolibérale.
Ces atouts justifient amplement le choix de Washington. Encore fallait-il trouver un moyen de pénétrer au Sénégal. Ce moyen, c’est le conflit en Casamance qui le procure.
Parmi des dizaines de conflits à travers le monde […], nous avons réalisé que le conflit en Casamance retarde le développement économique du Sénégal et immobilise des forces militaires dont on a besoin10 pour les missions de maintien de la paix. Un petit investissement en diplomatie expéditionnaire11 pourrait, pensions-nous, non seulement contribuer à des objectifs humanitaires, mais aussi promouvoir notre intérêt dans la croissance économique du Sénégal et son leadership régional continu en maintien de la paix. (Bullington, 2013, pp. 3-4)
Pour la diplomatie américaine, il est clair que mettre fin au conflit en Casamance constitue une opportunité, et apparaît donc plus comme un moyen que comme une fin : moyen de sécuriser une zone à risques et de faire du Sénégal un point d’appui. C’est ce qu’on appelle faire d’une pierre deux coups…
Une zone à risques
L’insécurité et l’instabilité des pays voisins, Gambie et Guinée-Bissau, contribuent à la prolongation du conflit en Casamance, autant que la prolongation de ce conflit contribue à leur insécurité et à leur instabilité. Contrairement à ce qu’avance le discours du MFDC12, leur appui à la rébellion pendant de nombreuses années a moins à voir avec des affinités ethniques qu’à des enjeux de pouvoir, à travers des contentieux avec le Sénégal : contentieux lié aux conséquences de l’emboîtement sénégalo-gambien (« coupure gambienne », notamment), contentieux sur le tracé de la Zone économique exclusive (ZEE) entre Sénégal et Guinée-Bissau. Ces contentieux ont été plus ou moins durablement réglés, et l’arrivée au pouvoir de nouveaux dirigeants, Adama Barrow à Banjul, en 2017, et Umaro Sissoko Embalo à Bissau, en 2020, place désormais ces pays dans la zone d’influence de Dakar. Ce retournement d’alliances contribue largement à l’asphyxie de la rébellion. Mais la zone n’en reste pas moins instable et dangereuse, en raison, notamment, de la persistance de trafics illicites, auxquels les États-Unis s’intéressent particulièrement. La Guinée-Bissau est ainsi connue depuis longtemps pour être une plaque tournante du trafic de cocaïne latino-américaine à destination de l’Europe, trafic dans lequel une partie de ses forces armées a été directement impliquée13, et qui constitue la toile de fond de coups d’État à répétition. Déjà mêlée au trafic des « diamants de sang » de Sierra Leone à la fin des années 1990, la Gambie tend aujourd’hui à s’intégrer dans ce circuit, comme le révèlent de grosses saisies de drogue opérées en 2020. Les gains qui en résultent sont, selon toute vraisemblance, affectés pour une part à des achats d’armes, comme celles qui ont été saisies en 2010 au Nigéria, dans une cargaison d’origine iranienne adressée au siège de la présidence gambienne : au moins une partie était manifestement destinée aux maquisards de Salif Sadio.14 Lors de cette affaire, l’existence de réseaux criminels dans l’entourage du président Jammeh, dont certains pourraient être liés au Hezbollah libanais15, a été évoquée par les médias.
Ce qui renvoie à l’autre grand risque dans la zone, le risque djihadiste et terroriste. Si le Sénégal n’a pas été frappé jusqu’à présent, la perception d’une menace y est de plus en plus forte : présenté comme un rempart, le modèle dominant d’islam confrérique souffre de ses liens historiques avec un État lui-même très lié à l’Occident. La menace est aussi bien intérieure qu’extérieure, avec notamment le risque de connexions entre l’idéologie salafiste, qui progresse inexorablement au sein de la population, et des individus ou des groupes « radicalisés » (djihadistes maliens ou mauritaniens, mais aussi sénégalais, de retour de Syrie ou de Libye). Des cellules ont été identifiées, des suspects arrêtés, certains jugés. Sont considérées comme particulièrement à risque, outre la capitale, les zones frontalières et les zones touristiques. La Casamance est donc doublement concernée. Y intervenir offre aux Américains la possibilité de mieux surveiller la zone en même temps qu’elle leur offre une occasion de pénétrer au Sénégal, le conflit faisant à cet égard office de cheval de Troie. Les deux objectifs sont d’ailleurs étroitement liés, puisque le renforcement des capacités économiques et militaires du pays est censé l’aider à écarter les menaces qui pèsent sur lui et sur l’ensemble de la sous-région : conflit séparatiste, trafics, terrorisme… La tâche est d’autant plus urgente que, comme le montre l’exemple du Mali, des connexions sont possibles entre les multiples acteurs politico-militaires, politico-religieux ou mafieux, un même acteur pouvant passer d’un registre à l’autre, voire en combiner plusieurs…
La bonne méthode : soft power et smart power
A partir de 2012, le second mandat du président Obama est marqué par une réorientation de la politique extérieure des États-Unis, sous l’impulsion de la nouvelle Secrétaire d’État, Hillary Clinton. Si l’objectif de puissance reste le même, la manière de l’exercer met l’accent sur d’autres approches, tenant compte non seulement de contraintes budgétaires ou de la nature asymétrique des nouveaux conflits, mais aussi de l’image qu’ils donnent des États-Unis. Ces nouvelles approches relèvent du soft power (la puissance douce), un concept forgé en 1990 par Joseph Nye, dans le contexte de l’effondrement du bloc soviétique, de l’avènement par défaut d’un monde unipolaire, et des interrogations sur la capacité des États-Unis à y conserver leur leadership. Face aux tenants de la thèse d’un déclin américain, Nye voit dans le soft power « la capacité d’un pays à structurer une situation de telle manière que d’autres pays développent des préférences ou définissent leurs intérêts en harmonie avec les siens » (Nye, 2004). Le concept évolue par la suite, finissant par désigner un type de pouvoir reposant sur la séduction et l’attractivité plus que sur la force.16 Si le concept est nouveau, ce qu’il recouvre ne l’est pas. Carnes Lord remarque ainsi que le soft power a été « un élément fort au service des États-Unis depuis leur création - certainement longtemps avant qu’au XXe siècle le pays ne devienne une puissance mondiale reconnue » (Lord, 2005, p. 62). Reconnaissant que le concept ne suffit pas, J. Nye en propose par la suite un nouveau, celui de smart power (la « puissance intelligente »), dans lequel la puissance résulte d’une combinaison de soft (l’influence d’un modèle) et de hard (le recours à la force si nécessaire). On peut en voir une illustration dans l’implication américaine en Casamance : le recours à la force y est à la fois délégué (à l’armée sénégalaise), légitimé (sécurisation des populations, développement) et mesuré (étalage de la force pour ne pas avoir à s’en servir). De quoi conforter l’image de Dakar, aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur. Dans le même temps, est mise en œuvre une « diplomatie expéditionnaire »17 pensée comme « une intervention sur une courte durée et avec des objectifs bien définis », visant à « prévenir, maîtriser et mettre un terme aux conflits en utilisant des ressources limitées, prioritairement non-militaires » (Bullington, 2013, p. 1). Gérée par un Bureau des conflits et opérations de stabilisation, le CSO18, au sein du Département d’État, c’est ce concept, déjà utilisé dans d’autres situations19, qui guide les premiers pas de Washington dans le dossier casamançais.
Le bon moment
L’intérêt américain pour le Sénégal, y compris pour le conflit en Casamance, n’est pas nouveau, puisqu’il remonte à la présidence Clinton, à la fin des années 1990. Mais il faut attendre 2012 pour qu’il se concrétise, à la faveur d’évolutions politiques.
L’effacement de la France
Les visées américaines ont été pendant longtemps mises en veilleuse en raison de l’influence française dans la zone. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si la France est le premier pays étranger à s’impliquer dans le dossier casamançais, à la demande des dirigeants indépendantistes, et bien sûr avec l’accord de Dakar. Pourtant échaudés par un « témoignage » historique sur le statut colonial de la région, qu’ils avaient imprudemment demandé et qui leur était défavorable20, mais persuadés que Paris détient la clé juridique du dossier, les responsables du MFDC acceptent quatre ans plus tard la médiation de l’ambassadeur André Lewin. Médiation menée à titre personnel mais couverte par l’Elysée. Après des débuts prometteurs21, la tentative tourne court. Au-delà du contexte de l’époque22, son échec illustre la difficulté pour une ancienne puissance coloniale à intervenir dans les affaires internes d’une de ses ex-colonies. Du moins quand ses intérêts vitaux ne sont pas en jeu, ce qui est le cas en Casamance. Mais aussi quand la société civile du pays concerné mobilise le registre anticolonialiste, comme c’est de plus en plus le cas au Sénégal (et ailleurs), pour exprimer son mécontentement.
Cet échec diplomatique laisse la porte ouverte à d’autres initiatives et à d’autres intervenants extérieurs. Très présents sur le terrain de l’aide, à travers leurs agences de développement ou à travers des ONG, Allemands ou Espagnols auraient notamment pu en profiter. Mais, tout en contribuant de facto à la réussite des objectifs de l’État, pour qui « le développement, c’est la paix ! », ils ne s’impliquent pas dans le règlement du conflit lui-même. Quant à l’Union européenne, son implication reste discrète, sous la forme d’un appui au Centre for Humanitarian Dialogue (HD), une ONG suisse qui offre notamment à des rebelles « repentis » 23 des « stages de sensibilisation à la paix ».
La voie est donc libre pour les Américains, et ils s’y lancent d’autant plus que les Français eux-mêmes leur ont préparé le terrain. Ainsi, la proposition de collaboration militaire dans la lutte antiterroriste que leur a faite le président Sarkozy en 2009 a-t-elle été perçue comme une aubaine, pouvant « fournir aux États-Unis des opportunités pour étendre leur influence en Afrique sans avoir à faire face à la résistance ou à l’interférence française ».24 L’année suivante, le retrait des forces françaises de Dakar (les FFCV)25, programmé mais avancé sous la pression du président Wade (pour des raisons de politique intérieure), va dans le même sens, affaiblissant un peu plus l’influence de Paris au profit de celle de Washington. Et cela d’autant plus que la France devient tributaire des Américains au Sahel. La convergence de vues entre les deux pays en matière de lutte antiterroriste y vaut à l’armée française, engagée dans l’opération Barkhane, de profiter de la logistique de son allié. Mais au prix de la reconnaissance de l’intrusion de ce dernier dans le pré carré de Paris…
Les premiers pas
L’implication américaine en Casamance se concrétise à partir de 2000, sous forme économique. Elle bénéficie de l’attention particulière qu’accorde le président Wade, sinon au conflit qui s’y déroule, du moins à une région qui est depuis longtemps l’un des fiefs de son parti, le Parti démocratique sénégalais (PDS). En dépit de sa promesse de régler le conflit en 100 jours, et des espoirs qu’elle a suscités, le nouveau président cherche en réalité moins à ramener la paix qu’à consolider, voire élargir, sa base électorale dans la région (Marut, 2013). C’est pourquoi il a tout à gagner dans un financement extérieur d’infrastructures qu’il pourra porter à son actif. Affichant ostensiblement son attachement tant au libéralisme qu’aux États-Unis qui l’incarnent, il permet à son pays de figurer parmi les bénéficiaires de l’aide américaine, notamment grâce aux « compacts » de la Millenium Challenge Corporation (MCC)26, dont la Casamance reçoit une bonne part. Mais la région bénéficie également de nombreuses autres initiatives publiques ou privées : après l’USAID27, de nombreuses organisations non gouvernementales (ONG), telles Africare, Catholic Relief Service, World Education ou World Vision, pour la plupart d’inspiration chrétienne, s’implantent dans la région au début des années 2000. Comme d’autres, elles y contribuent à la réalisation d’objectifs gouvernementaux dont elles partagent globalement les présupposés idéologiques (une dépolitisation des enjeux) : à l’instar de l’État sénégalais et des bailleurs de fonds extérieurs, ces ONG présentent en effet le développement (ou ce qui est considéré comme tel) comme le meilleur moyen de ramener la paix. C’est pourquoi, avec l’appui de l’USAID, elles placent leurs interventions sous le signe du Peace Building (la construction de la paix), un concept inspiré par la non-violence de Ghandi, et repris à leur compte par l’ONU, l’UA et la CEDEAO. Né aux États-Unis au lendemain de la Guerre froide, ce modèle culturaliste, censé résoudre les nouveaux types de conflits (identitaires et asymétriques pour la plupart), s’appuie sur le local et sur la tradition (Ayissi, 2002). Au même titre que le développement endogène prôné à la même époque, notamment par l’USAID avec ses Grassroots initiatives (initiatives de la base), le Peace Building place, sinon les peuples, du moins la société civile et non plus les États, au cœur des préoccupations de la diplomatie préventive et du développement : stratégie qui, à défaut d’atteindre les objectifs qu’elle affiche, conforte des organisations de la société civile, voire des entrepreneurs politiques, qui vont faire d’une tradition plus ou moins réinventée et folklorisée leur fonds de commerce.
Mais les ambitions américaines restent bridées par la posture nationaliste de Wade, qui refuse toute ingérence extérieure dans le dossier. Et elles sont ensuite suspendues par la crispation d’un régime dont l’administration Obama dénonce des dérives (autoritarisme, népotisme, corruption…), jugées peu compatibles avec le modèle américain de gouvernance. En 2012, la tentative d’Abdoulaye Wade de s’accrocher au pouvoir pour un troisième mandat est la goutte de trop aux yeux des Américains : leur décision de geler le versement des fonds de la MCC au Sénégal apparaît comme un désaveu de Wade, en même temps qu’un soutien indirect à son rival Macky Sall.
Le tournant de 2012
L’implication politique de Washington en Casamance bénéficie de la concomitance de changements, sinon d’objectifs, du moins de méthodes, à la suite des scrutins présidentiels qui voient la réélection de Barak Obama aux États-Unis et l’élection de Macky Sall au Sénégal.
À Dakar, le départ d’Abdoulaye Wade lève les obstacles, tandis que son successeur, qui se déclare ouvert à une aide extérieure, offre à Washington l’occasion rêvée pour jouer les pompiers et éteindre un feu déjà largement maîtrisé : deux groupes de maquisards sur trois ont déjà été neutralisés (le Front Nord/Diakaye, de Kamougué Diatta et Ismaïla Magne, et le Front Sud/Cassolol, de Léopold Sagna et César Badiate), tandis que le groupe de Salif Sadio poursuit seul la lutte armée près de la frontière gambienne. Et par ailleurs la rébellion a perdu une bonne part de ses soutiens initiaux parmi une population aspirant avant tout au retour de la paix. Envoyée dans la capitale sénégalaise pour surveiller le scrutin présidentiel et ses suites, une mission du CSO saisit au bond la balle lancée par le nouveau président en envisageant, non pas une médiation, mais un appui au processus de paix de l’État sénégalais. L’équipe rédige une proposition en ce sens, qu’Hillary Clinton, en visite à Dakar en juillet 2012, remet à Macky Sall, qui l’accepte aussitôt. Se défendant de vouloir faire la paix à la place de l’État sénégalais, les États-Unis se posent en simples « facilitateurs ». Sous les auspices de la « diplomatie expéditionnaire », ils créent un poste de conseiller spécial pour la Casamance auprès de leur ambassade à Dakar, que des diplomates chevronnés à la retraite occupent successivement de 2012 à 2015.28 Très actifs, ils multiplient les rencontres avec les différents protagonistes : du côté de l’État sénégalais, le président Sall et l’amiral Sarr, chef du Renseignement, chargé du dossier, et du côté du MFDC, de nombreux responsables civils et militaires, notamment César Badiate, le chef de la faction combattante de Cassolol.29
Même si le scénario n’est pas écrit à l’avance, le but des Américains est clair. Au-delà de la fin d’un conflit interminable qui mobilise des forces qui leur seraient plus utiles ailleurs, ce qu’ils visent c’est la consolidation d’un point d’appui à leur politique africaine. En acceptant leurs bons offices, Macky Sall leur en offre la possibilité : l’État sénégalais y trouve son compte, aussi bien en termes de légitimité de son action en Casamance qu’en termes matériels. Dans ce dernier domaine, bien que couvert en partie par l’aide extérieure, le coût du conflit, jamais divulgué, et qui n’est pas réductible aux seules opérations militaires, pèse en effet sur le budget et sur la croissance.
Seuls acteurs extérieurs, avec la communauté catholique romaine de Sant’Egidio, à s’engager dans ce dossier, les diplomates américains choisissent de cibler comme interlocuteurs privilégiés les ailes militaires du MFDC plutôt que ses ailes civiles. Le choix semble logique, puisque découlant du constat d’absence de leadership et de fragmentation du mouvement indépendantiste en factions rivales, voire ennemies. Fragiles sur le plan politique et idéologique, déconnectés des réalités sociales, coupés des combattants, faute de moyens financiers suffisants pour les soutenir, les chefs des ailes civiles ont en effet perdu tout ou partie de leur légitimité au profit de chefs militaires livrés à eux-mêmes : malgré leurs faiblesses idéologiques et politiques, ces derniers sont devenus par défaut les interlocuteurs les plus significatifs du côté du MFDC.
C’est un constat qu’a fait depuis longtemps l’État sénégalais en menant un travail de sape à leur encontre, travail qui a manifestement porté ses fruits. Depuis l’échec d’une tentative de solution militaire dans les années 1980, Dakar joue sur les divisions de l’aile combattante de la rébellion pour la neutraliser groupe après groupe. D’abord le Front Nord (Diakaye) par Abdou Diouf, au lendemain du premier cessez-le feu (1991). Puis une partie du Front Sud par Abdoulaye Wade, à partir de 2000. Mais il restait à neutraliser l’autre grande composante de ce Front Sud, la faction radicale de Salif Sadio, seule à poursuivre la lutte armée, cible à la fois de l’État sénégalais et des autres groupes rebelles (qui ont déposé les armes, mais ne les ont pas rendues). C’est à une coalition réunissant l’armée de Bissau (devenu allié de Dakar) et le plus important de ces groupes, celui de César Badiate, qu’est laissée la tâche. En 2006, la coalition réussit à déloger Sadio de ses positions à la frontière sud. Mais, malgré les militaires sénégalais qui tentent de lui barrer la route, celui-ci se réfugie au nord, à la frontière gambienne : il y trouve à la fois une nouvelle base arrière et un soutien sans faille du président Jammeh. Pour Dakar, le problème Sadio reste donc entier. C’est ce problème que Macky Sall entend bien résoudre dès son arrivée au pouvoir en 2012, mais d’une manière beaucoup plus subtile : il propose en effet au chef rebelle l’ouverture de discussions. Un choix logique (on ne peut faire la paix qu’avec ceux qui font la guerre) en même temps que très habile : isolé jusque-là, Salif Sadio saisit ce qui lui apparaît, non sans raisons, comme une opportunité (sans doute la seule) de sortir de son isolement, d’accéder à une reconnaissance nationale et internationale, et d’intégrer un jeu politico-diplomatique dans lequel il apparaît non seulement comme l’interlocuteur privilégié de l’État, mais aussi, de fait, comme le seul représentant officiel de la rébellion.
C’est à ce volet de la stratégie gouvernementale que la diplomatie américaine apporte d’emblée son appui, avant de s’investir directement sur un autre terrain.
Le soft power en actes
Présentées comme des « négociations » par les protagonistes, les rencontres entre émissaires de S. Sadio et représentants de l’État - d’anciens diplomates, conduits par l’amiral Sarr -, se tiennent à partir d’octobre 2012 à Rome, dans les locaux et avec la médiation de la Communauté catholique de Sant’Egidio.30 Devenue experte en diplomatie parallèle et discrète, ce qui lui a valu le surnom de « petite ONU du Trastevere » (quartier de Rome), la communauté doit sa notoriété à des médiations difficiles dans différents conflits, et à quelques réussites marquantes, comme les accords de paix au Mozambique en 1992 : de quoi lui assurer le soutien d’une diplomatie américaine moins expérimentée en Afrique. Soutien financier, qui permet la prise en charge des voyages et l’hébergement des émissaires, mais encore plus soutien symbolique : la caution de la première puissance mondiale à l’initiative d’une structure, certes indépendante, mais considérée comme proche du Vatican. Pour des raisons différentes, la diplomatie des États-Unis et celle du Saint-Siège31 ont ici le même intérêt à mettre un terme le plus rapidement possible au conflit.32 Mais le choix de discuter avec le seul Salif Sadio a des effets pervers tout-à-fait prévisibles, et probablement prévus. Rien n’étant manifestement envisagé pour eux, les autres groupes se retrouvent en effet hors-jeu, et ne peuvent qu’afficher leur hostilité à un processus qui les exclut. Dakar fait ainsi d’une pierre deux coups : la neutralisation de fait du groupe Sadio et une division accrue de l’aile combattante rebelle. Mais au risque d’une surenchère et d’une reprise de la violence.
C’est ce risque que les Américains écartent en nouant le dialogue avec le principal groupe restant, celui de César Atoute Badiate. Pour le neutraliser à son tour, ils utilisent un levier redoutablement efficace : la pression des populations sur des rebelles qui prétendent les représenter. Et cette pression est d’autant plus forte qu’elle a pour enjeu l’attribution ou la perspective de nouvelles ressources pour les villageois. Sans attendre, les Américains lancent en effet un vaste programme d’infrastructures destinées à désenclaver la zone s’étendant à l’est de Ziguinchor :
réfection complète des 186 km de la route qui relie la capitale régionale à Kolda, financée pour l’essentiel par la MCC ;
création ou réfection de 130 km de pistes de production, qui s’enfoncent jusqu’à la frontière bissau-guinéenne, perpendiculairement à la grande route.
Financée par le Département américain de l’agriculture (USDA), cette dernière opération est réalisée par le bureau ziguinchorois de l’ONG Shelter For Life, dans le cadre d’un programme de développement plus global qu’elle conduit dans le département de Niaguis. Un tel choix paraît pertinent, dans une zone particulièrement éprouvée par le conflit depuis ses débuts.33 C’est notamment le cas dans la commune de Boutoupa-Camaracounda, où de nombreux villages ont depuis longtemps été vidés de leur population (plusieurs milliers d’habitants), réfugiée de l’autre côté de la frontière ou repliée dans les centres urbains. Ce qui n’empêche pas les ressources locales (bois, fruits, bétail…) d’y être l’enjeu de rivalités parfois sanglantes entre différents acteurs, civils et militaires, dans une zone truffée de mines, qui protègent à la fois les positions des combattants, rebelles ou gouvernementaux, et l’accès aux ressources. D’où l’objectif, a priori légitime, d’un retour des populations et d’une relance des activités. Pour cela, l’ONG fournit des ressources en numéraire (des salaires pour l’aménagement des pistes) ou en nature (semences, plants). Mais aussi la promesse de revenus substantiels à court terme grâce à son appui à la filière anacarde. Parallèlement, le retour des villageois est encouragé par le Département d’État américain, qui finance la couverture des maisons.34 Encore faut-il au préalable déminer la zone. Et là encore on retrouve les États-Unis pour financer un programme de déminage humanitaire coordonné par le Centre national anti-mines, et réalisé jusqu’en 2018 par l’ONG Handicap International.
Ayant valeur d’exemplarité, ce programme de développement est à la fois cohérent (tous les aspects de la vie quotidienne sont pris en compte) et bien ciblé, grâce à des intermédiaires ayant une bonne connaissance du terrain et des acteurs. La coordination entre les différentes catégories d’intervenants, qu’ils soient institutionnels, gouvernementaux (ambassade, ministères) ou paraétatiques (USAID, MCC), ou qu’ils soient privés (ONG, cabinets de management), est assurée par l’ambassade : des réunions régulières permettent d’analyser la situation sur le terrain, d’harmoniser les interventions, de répartir les moyens.
Avec ces programmes, les États-Unis démontrent leur savoir-faire dans une partie de la Casamance, et ils ne manquent pas de le faire savoir. Tout au long de la route, jusqu’au pont de Kolda, des panneaux géants indiquent à qui l’ignorerait que ces réalisations sont un « don du peuple américain ». Et, sur le même axe, à l’entrée de chaque piste de production comme dans le moindre village, d’innombrables panneaux, plus modestes, mentionnent les programmes et les différents intervenants américains. Où il apparaît que ces réalisations, dont l’utilité n’est pas contestable, s’inscrivent dans un dispositif de pouvoir, tel que le définit Foucault (1975) : « un ensemble hétérogène constitué de discours, d’institutions, d’aménagements architecturaux, de règles et de lois, etc. », qui s’inscrivent dans une stratégie de pouvoir, visant à modifier un rapport de forces. Sur ce point, la brochure promotionnelle de Shelter For Life est on ne peut plus explicite : ces programmes ont « aussi » pour but d’« appuyer la politique étrangère des États-Unis ».35 Un objectif qui ne tarde pas à se concrétiser, puisqu’un accord de défense est signé à Dakar en 2016, autorisant la présence de militaires américains au Sénégal pour lutter contre la menace terroriste en Afrique de l’Ouest. Si la perspective d’une base permanente est écartée36, un tel accord n’en constitue pas moins une première dans cette zone, confortant Dakar dans son rôle de centre logistique de l’armée américaine. Pour ce faire, la mise à sa disposition par l’armée sénégalaise de l’ancienne base française de Ouakam (Dakar) constitue une aubaine, dont se réjouit ouvertement le commandant de l’Africom (commandement militaire américain pour l’Afrique), lors de sa visite en 2018.37 Il se trouve que l’armée américaine avait déjà testé cette base en 2014, lors de son intervention humanitaire dans les pays africains touchés par le virus Ebola. Simple coïncidence ? Certainement pas : sa forte implication dans le domaine de la santé sur un continent où il y a certes beaucoup à faire, est un autre dispositif du soft power de Washington, comme en témoigne la tournée, très médiatisée, d’une équipe de médecins militaires américains en Casamance en 2018. Comme les trains, les objectifs humanitaires peuvent parfois en cacher d’autres, moins désintéressés…
Les limites de l’exercice : le dessous des cartes
Avec peu de moyens mais beaucoup d’habileté, les États-Unis réussissent indéniablement à booster38 le processus de l’État sénégalais visant à mettre un terme au conflit en Casamance. Est-ce pour autant un gage de paix et de développement pour la région ?
Développement durable ou fragilisation ? Le modèle libéral
« Le développement, c’est la paix ! », ne cessent de répéter les représentants de l’État sénégalais. Après l’abandon de la « diplomatie expéditionnaire », le programme « 3 D » (diplomatie, développement, défense) défendu par le nouvel ambassadeur des États-Unis au lendemain de la tuerie de Boffa-Bayote en 201839 reprend la même antienne. Mais de quel développement est-il question ?
Selon l’ONG Shelter For Life, qui les met en œuvre en Casamance comme ailleurs, les programmes que finance l’USDA ont certes pour but d’améliorer les conditions de vie des producteurs. Mais cela, « via » l’insertion dans « le marché mondial », obtenue par une stratégie d’extraversion (monoculture d’exportation de la noix de cajou notamment) et une intégration sous-régionale visant à faire du Sénégal, de la Gambie et de la Guinée-Bissau (programme « SeGaBi ») « une seule région économique ». Pour les Américains, il s’agit donc non seulement d’encadrer et financer pour produire plus et mieux, vendre plus, acheter plus, mais aussi de créer un marché sous-régional unifié et stabilisé pour l’intégrer plus facilement dans le marché mondial. Ce que confirme, dans les tiroirs de l’ONG, le projet de création d’un nouvel axe routier permettant de relier directement Bissau à Dakar sans passer par Ziguinchor, via Ingoré (Guinée-Bissau), Sédhiou (Casamance) et la Transgambienne, moyennant la construction d’un deuxième pont sur la Casamance. L’insertion de la région dans l’économie mondiale serait donc la réponse au conflit et à l’insécurité dans la zone. Mais à quel prix ?
Au cœur du dispositif américain, le programme anacarde vise certes à procurer rapidement des ressources monétaires aux villageois victimes du conflit. Mais un tel résultat est à la fois incertain et d’un coût social et environnemental élevé. Résultat incertain dans la mesure où, comme pour tous les produits de base, les revenus attendus de cette culture commerciale dépendent de cours mondiaux fluctuants. Le programme a été lancé dans une phase de hausse des cours de la noix de cajou, alimentée par l’explosion de la demande des pays riches. Mais, comme souvent en matière de produits de base, l’offre a vite dépassé la demande, provoquant en 2019 un effondrement des cours, et donc des revenus des producteurs. L’exemple de la Guinée-Bissau, depuis longtemps convertie à la culture de l’anacarde, est éloquent : les petits exploitants y ont souvent des difficultés à acheter une nourriture qu’ils ne produisent plus, ou plus suffisamment, en raison d’une chute des cours de la noix de cajou à laquelle leur production a contribué ! On est bien à l’opposé d’un modèle de développement durable tel que celui prôné par la CNUCED.40 Loin d’être la panacée, le choix d’une agriculture spéculative au détriment d’une agriculture vivrière ne fait en réalité qu’accroître la dépendance du pays et l’insécurité alimentaire des petits producteurs. S’y ajoutent les risques environnementaux inhérents aux monocultures d’exportation, à commencer par l’accélération de la déforestation et de ses conséquences en termes de réchauffement climatique et de perte de biodiversité.
A défaut de développement véritable, le programme américain contribue-t-il au moins à la paix, comme l’affirme le discours officiel ? Là encore, à moins de confondre les registres entre arrêt des combats et paix durable, les résultats sont loin de ce qui est affiché.
Paix durable ou piège à maquis ? La stratégie de l’araignée41
L’implication diplomatique des États-Unis dans le dossier casamançais à partir de 2012 ne signifie pas qu’ils en étaient totalement absents jusque-là, même si c’est sous d’autres formes et de manière indirecte. Au même titre que la France, ils apportent en effet depuis longtemps un soutien militaire à l’armée sénégalaise, à charge pour elle de participer à des opérations de maintien de la paix sur le continent, voire au-delà. Il est évident que, aussi bien en termes de matériels que de formation et d’expérience, et même si ce n’est pas sa finalité, ce soutien contribue à muscler les capacités opérationnelles de cette armée en Casamance. Dakar a certes renoncé depuis longtemps à une réponse exclusivement militaire, dont les résultats seraient non seulement aléatoires, mais également contre-productifs pour un pays qui fait de son image de « vitrine de la démocratie » une rente de situation. Mais les dirigeants sénégalais successifs n’ont jamais renoncé à recourir à la force, moins pour écraser la rébellion - pour autant que ce soit réalisable - que pour l’affaiblir un peu plus, quand les circonstances le permettent. C’est là que l’assistance militaire étrangère, notamment celle des États-Unis, joue un rôle essentiel : en aidant l’armée sénégalaise à devenir l’une des meilleures du continent, elle contribue à sa maîtrise du terrain en Casamance. Mais un tel résultat est tout autant à porter à l’actif de la diplomatie de Washington, qui, depuis 2012, a fortement contribué à neutraliser en douceur les chefs de maquis, que ce soit de manière indirecte à Rome, ou de manière directe sur le terrain.
Les discussions de Rome ont certes permis des résultats conformes à leurs objectifs déclarés : la libération sans contrepartie, mais très médiatisée, de militaires sénégalais détenus par Salif Sadio, fin 2012, un cessez-le-feu unilatéral proclamé par ce même Sadio en 2014, ou encore la libération par Dakar de deux de ses combattants au début de l’année 2018. Sant’Egidio a également fait état d’avancées dans les négociations, y compris sur la question du statut de la Casamance. Mais le peu de résultats, l’espacement des rencontres, voire l’absence d’une des deux parties (représentants de l’État ou de la rébellion) montrent bien les blocages auxquels se heurte la médiation. Une part en incombe à S. Sadio, dans la mesure où, à l’instar des autres responsables du MFDC, il n’a d’autre projet politique à proposer que l’indépendance. Mais ces blocages incombent autant, sinon plus, à l’État sénégalais, que sa position dans le rapport de forces incite à refuser toute concession, qui redonnerait au chef rebelle une importance qu’il n’a plus. Et qu’il a encore moins depuis l’intervention sénégalaise en Gambie en 2017, sous couvert de la CEDEAO42, pour contraindre son protecteur Yahya Jammeh à quitter le pouvoir. Isolé des autres groupes rebelles, coupé de sa base arrière et pris en tenaille par les militaires sénégalais déployés à la fois en Gambie et en Casamance, S. Sadio voit désormais sa marge de manœuvre considérablement réduite sur le plan militaire, sans qu’il ait pour autant obtenu d’avancées significatives sur le plan politique. Tout se passe comme si, en saisissant l’opportunité qui lui était offerte de sortir de son isolement en 2012, Salif Sadio - avait-il le choix ? - s’était fait piéger par Dakar dans des discussions interminables dont il n’avait a priori pas grand-chose à attendre. Même si ce n’était pas le but, c’est le résultat. Et c’est probablement ce que le chef rebelle a fini par comprendre, et qui expliquerait sa menace de reprendre les armes pour contraindre l’État à une véritable négociation, qu’il réclame toujours haut et fort. Mais que pourrait-il désormais espérer d’une action militaire, sinon un baroud d’honneur ?
Bien que se posant en termes différents, la situation n’est pas meilleure au sud pour la faction rivale de César Badiate. S’estimant non sans raison marginalisé par le processus de Rome, le chef de Cassolol, à la différence de S. Sadio, n’avait guère d’autre choix que de radicaliser son discours et de « montrer ses muscles » pour rappeler qu’il existe et qu’il faut compter avec lui. La première conséquence, paradoxale, de l’entrée de Sadio dans le jeu politique est donc le risque d’une relance de la violence dans le sud et l’ouest de la région, par des groupes qu’on n’entendait plus depuis longtemps. C’est ce risque que les Américains écartent en neutralisant de fait César Badiate.
Ils y parviennent d’autant mieux que « César » leur a tendu la perche en leur demandant d’accueillir sur leur territoire (aux États-Unis, donc) à la fois des assises du MFDC et la négociation entre un MFDC «new look» et l’État sénégalais, qui aurait été pour lui une manière d’écarter les « durs » de l’aile civile (Nkrumah Sané) et ceux de l’aile militaire (Salif Sadio). Le chef rebelle semble alors en position de force pour négocier : la réalisation des programmes de déminage et de développement n’est en effet possible qu’avec son accord, puisque ses cantonnements sont à proximité, le long de la frontière avec la Guinée-Bissau. Or, donner son accord serait doublement périlleux pour lui :
sur le plan militaire, en mettant en danger sa sécurité : au nom de la sécurisation des villageois, l’Armée en profiterait pour se rapprocher des positions rebelles.
sur le plan économique, en compromettant une économie de guerre qui repose sur le contrôle du territoire et de ses ressources (forestières, agricoles, frontalières…).
Mais ne pas donner son accord aurait des conséquences tout aussi graves, sur le plan politique cette fois, avec le risque de s’aliéner encore plus la population. Et c’est bien là le talon d’Achille de la rébellion dans son ensemble : comment prétendre être le porte-parole des Casamançais et refuser en même temps d’accéder à leurs demandes légitimes ? C’est cette contradiction qu’exploite habilement la stratégie américaine dans la zone : utiliser la pression des populations sur la rébellion comme un levier pour lui faire céder peu à peu du terrain, la priver d’air en quelque sorte. D’où des négociations serrées, au cas par cas, entre acteurs américains (institutionnels ou ONG), populations et maquisards, négociations dans lesquelles l’implication d’élus locaux peut s’avérer efficace. César Badiate n’a en réalité pas d’autre choix que d’accepter ces rencontres, ne pouvant se couper des populations, et encore moins des Américains, qui constituent sa meilleure, sinon sa seule véritable carte politique. Aussi doit-il accepter des concessions, quitte à fixer des limites : des démineurs sont ainsi capturés pour avoir franchi une ligne rouge édictée par le chef maquisard. Mais, peu à peu, c’est tout le territoire contrôlé par la faction de Cassolol qui se trouve réduit, morcelé, encerclé. Jusqu’à l’estocade portée par les Diambars.43 Une première fois, à la suite de la tuerie de Boffa Bayote, en janvier 2018, où l’offensive gouvernementale disperse les combattants de Cassolol (ce qui rend difficiles leurs contacts avec les Américains). Une deuxième fois, en janvier-février 2021, où la faction dissidente et incontrôlée de Sikoune44, à l’est de Ziguinchor, est, elle aussi, contrainte d’abandonner ses cantonnements à la suite d’une nouvelle offensive, très médiatisée, de l’armée. Dans l’un et l’autre cas, les maquisards abandonnent leurs positions plutôt que de livrer un combat sans espoir.
Ces succès consacrent l’efficacité de l’approche américaine du problème « par le bas », dont l’affichage socio-économique, au demeurant légitime, masque des finalités politico-militaires en phase avec celles de l’État : affaiblir la rébellion par tous les moyens, politiques et militaires, tout en proposant des alternatives, sous forme de promesses de développement et de paix. Mais un développement qui n’en est pas vraiment un, on l’a vu, et la promesse d’une paix qui n’en est pas vraiment une. Drôle de paix en effet, puisque faisant l’impasse sur les origines et les enjeux du conflit (un problème de représentation politique), et donc sur toute véritable perspective de règlement politique. Ne seraient négociables que les « aspects cultuels, culturels, économiques et de réinsertion des combattants ».45 Toute reconnaissance du point de vue indépendantiste, qui offrirait une alternative au MFDC (en lui permettant de mener son combat sur le terrain politique), reste exclue, comme le montre l’interdiction de meetings (d’abord autorisés) du groupe Sadio dans sa zone du Bignona. En bloquant ainsi toute issue politique, et donc, de fait, toute négociation, l’État ne laisse d’autre choix à ce qui reste du MFDC qu’entre la poursuite d’une lutte armée sans espoir ou l’acceptation d’une capitulation sans conditions. Au risque d’une reprise de la violence sur de nouvelles bases et avec de nouveaux acteurs.46 Telle apparaît in fine la logique du « processus de paix » gouvernemental auquel les États-Unis apportent leur appui.
Conclusion : what else?47
Depuis son implication officielle en 2012, la diplomatie américaine contribue efficacement à faire bouger les lignes en Casamance, laissant entrevoir une fin de cet interminable conflit. Elle n’impose rien, se bornant à accompagner le processus en cours depuis longtemps, qui vise à venir à bout de la rébellion sans avoir à négocier avec elle. En accélérant par divers moyens la neutralisation des maquis, tout en laissant à une armée sénégalaise dopée par Washington le soin de porter l’estocade, elle modifie le rapport de forces politico-militaire en faveur de Dakar. Mais, s’il va dans le sens d’une fin du conflit, ce mode de gestion ne garantit pas pour autant une paix durable, et cela pour au moins deux raisons : non seulement il ne s’attaque pas aux racines du conflit, mais il apporte des réponses qui renforcent les raisons de son émergence.
Sont en cause les priorités sécuritaires de chacun des deux pays. Pour Dakar, relever le défi lancé par le mouvement indépendantiste à l’affirmation d’un État-nation sénégalais. Pour les États-Unis, relever les défis lancés à leur puissance, sur des registres différents, tant par le djihadisme et le terrorisme que par la Chine. Leur soutien au Sénégal y contribue, dans la mesure où les objectifs de Dakar coïncident avec les leurs. Le pays de la Teranga48 trouve dans ce soutien de nouvelles ressources, symboliques et matérielles, qui contribuent à légitimer et donc à mieux faire accepter l’État dans sa périphérie méridionale.49 Où l’on peut voir une confirmation que la captation de ressources extérieures constitue le principal levier de l’État en Afrique (Bayart, 2006).
Sont en cause par ailleurs les réponses apportées. Au cœur des dispositifs de pouvoir des deux États, le couple sécurité-libéralisme est en effet celui-là même qui est à l’origine du problème qu’ils prétendent régler. En excluant de facto toute perspective politique, sa mise en œuvre montre que Washington comme Dakar cherchent moins à résoudre le conflit qu’à le dissoudre. Résoudre le conflit impliquerait en effet de s’attaquer à ses racines50, à savoir des choix de modèles économiques et politiques discutables, mais non discutés. Parce que présentés comme « naturels » et comme les seuls possibles, comme si d’autres possibles n’existaient pas.51 En Casamance comme dans le reste du Sénégal et ailleurs dans le monde, ce sont pourtant ces modèles qui sont à l’origine d’une profonde crise de la représentation politique : le sentiment de sous-représentation y favorise l’émergence de phénomènes de surreprésentation identitaire, de nature nationale ou ethnonationale, religieuse ou populiste. Et ce sont ces phénomènes identitaires dont s’emparent des entrepreneurs politiques en les instrumentalisant à des fins de pouvoir. Quoi qu’on en pense, les mouvements identitaires et leur instrumentalisation ne sont donc pas la cause, mais les révélateurs d’une crise. C’est pourquoi les éliminer ne résout pas plus les problèmes que casser un thermomètre ne fait tomber la fièvre. Résoudre ce conflit, comme d’autres, impliquerait l’existence d’un espace public permettant aux intéressés (non seulement les Casamançais, mais l’ensemble des Sénégalais) de débattre de leur avenir et des modèles à mettre en œuvre pour le construire, ce qui est la définition même du politique. Une démarche aux antipodes de la démarche de dirigeants qui cherchent à étouffer tout débat (« Ne vous mêlez pas de ça, nous on sait, laissez-nous faire ! »52). Au même titre que d’autres discours (sur « le développement », sur « la démocratie », ou sur « la bonne gouvernance »), le discours sur « la paix » en Casamance participe ainsi de ce que James Ferguson (1990), dans sa critique du « développement » en Afrique, nomme « machine antipolitique » («anti-politics machine»), où l’échec apparent de l’État et de ses soutiens, intérieurs et extérieurs, à atteindre les objectifs qu’ils affichent masque en fait l’imposition de modèles et de stratégies qui tournent le dos à ces objectifs, et qui sont à l’origine des problèmes qu’ils prétendent résoudre. Au risque de relancer la violence, peut-être sous d’autres formes et avec d’autres acteurs. Parler de « processus de paix » en Casamance relève donc davantage du mythe que de la réalité. Derrière le mythe, le véritable processus en cours est celui qui, à défaut de ramener une paix durable, permet à terme de renforcer l’État sénégalais, à l’intérieur comme à l’extérieur, au profit d’une pénétration des États-Unis en Afrique de l’Ouest qui utilise la Casamance comme cheval de Troie.